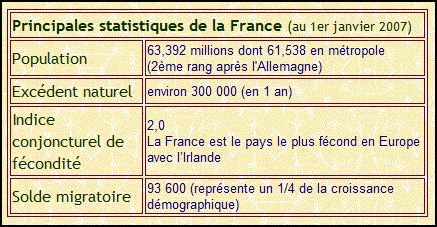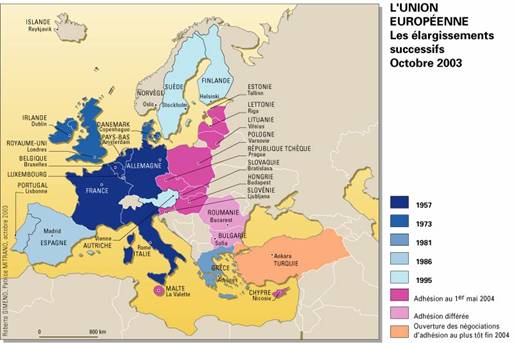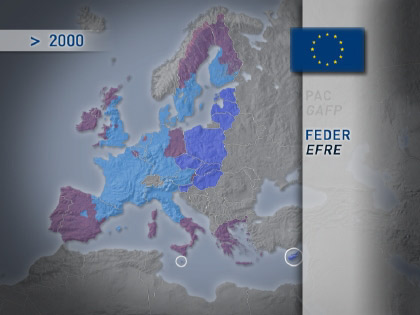|
Un programme conçu comme un emboîtement d’échelle, de la plus grande à la plus
petite
Autour de 2 pivots essentiels :
- le paysage, perception visuelle de l’espace
- la carte
pour localiser et décrire des lieux, de façon autonome, pour comprendre quels sont les points forts du monde actuel : les pays, les villes, les parties du monde dont on parle dans l’actualité…
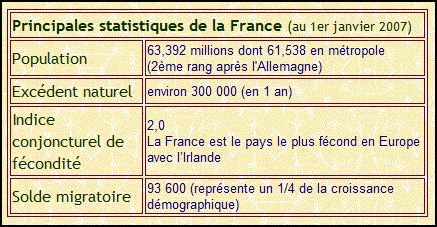
Des réalités géographiques locales à la région où vivent les
élèves (CE2)
Les paysages de village, de ville ou de quartier
. 80% d’urbains en France (« unité urbaine » > 2000 habitants), dans
des villes aux histoires, aux sites (leur localisation dans le cadre naturel -
site de fond d'estuaire comme Bordeaux, site de confluence comme Alfortville)
différents : villes d'origine gallo-romaine comme Arles, nées de la
Révolution industrielle comme Hagondange en Lorraine).
Des paysages urbains (de quartiers et de villes) très différents selon leur
localisation par rapport au centre :
. le centre ancien, la ville historique, au coeur de l'agglomération :
de
plus en plus réservés aux plus aisés, avec son patrimoine monumental,
ses services administratifs, ses rues commerçantes, ses quartiers
réhabilités, d'où sont exclues des populations modestes, dans un processus
de gentrification (reconversion d’entrepôts, de locaux industriels ou artisanaux).
La tertiarisation des quartiers centraux (informatique et textile dans le
XII° et XI° arrondissements de Paris au détriment des commerces de bouche
de proximité), leur standardisation (rues piétonnes – tramways –
magasins d'habillement et de téléphonie) excluent de
plus en plus les populations résidentes à faible pouvoir d’achat et affaiblit encore plus la mixité sociale…
. les quartiers d'affaires (tours de bureaux) sont un autre exemple de la
tertiarisation dans l'espace urbain : Mériadec à Bordeaux,
la Part-Dieu à Lyon, la Défense - le plus vaste d'Europe - à Paris
. les banlieues, dans la périphérie proche de la ville-centre (constituant
avec elle une agglomération) sont de nature et de forme diverses : quartiers
pavillonnaires, modestes ou aisés, ensembles collectifs plus ou moins longs,
plus ou moins élevés, avec une palette complète de banlieues,
résidentielles ou populaires.
. la couronne périurbaine : elle s'étend dans une zone mal définie, aux
limites imprécises, entre la frange exerne de l'agglomération et l'espace
rural environnant. Cet espace périurbain est le plus dynamique du territoire
national. C'est là que la population française s'accroit le plus vite, tout
en accueillant également de nombreuses activités de type urbain :
entreprises, zones commerciales et de service, voies de communication...
. le paysage original des villes nouvelles. C'est un projet (non abouti) de maîtrise de la croissance des agglomérations, d’organisation des périphéries, notamment parisienne, dans le cadre d’une politique volontariste d’aménagement du territoire,
dans les années 1960 : les villes nouvelles (Marne-la-Vallée, Saint
Quentin-en-Yvelines, Melun-Sénart, Evry, Cergy) proposant sur une
couronne à une trentaine de km de Paris d'importantes densités en hommes
et en activités pour "fixer" localement la croissance de
l'agglomération parisienne, jusque là anarchique et dévoreuse
d'espace... Certaines de ces villes-nouvelles sont particulièrement
dynamiques, attirant vers elles des cadres parisiens, mais elles n'ont pas
empêché le développement concomitant d'immenses lotissements pavillonnaires,
dévoreurs d'espace...
|

|
| Le modèle de
l'étalement urbain : la frange périurbaine de l'agglomération
de Reims, avec lotissements collectifs et pavillonnaires, espaces
de loisirs et de services, s'étendant sur les parcelles
agricoles... Aujourd'hui, ce sont les espaces ruraux, situés à
25 km du centre des agglomérations, qui sont les plus dynamiques
du territoire : ils accueillent les 3/4 de la croissance démographique
française. |
. 60% du territoire dévolu à l’agriculture – zones dynamiques
(grande culture céréalière du bassin parisien, régions viticoles de
grande qualité par exemple) et espaces en
déprise (polyculture de petites parcelles dans le piémont
pyrénéen...), ce qui se traduit dans les paysages par des friches,
l'abandon (ancien) des cultures en terrasses cévenoles étant une bonne
illustration...
On distingue traditionnellement les paysages de champs ouverts (openfield)
avec un habitat groupé en villages, et des paysages de bocage (parcelles
encloses séparées par des haies, pour l'élevage surtout), où l'habitat est
dispersé dans des fermes éparses. Le paysage méditerranéen est très
contrasté, entre vestiges de terrasses et cultures intensives des plaines
(vallée du Rhône provençale).
Du coup, les villages ruraux traditionnels se sont profondément transformés.
Partout, les agriculteurs, éleveurs, représentent une minorité,
vieillissante, de la population de ces villages. De différentes formes
(village-rue, village à place centrale, village perché dans le Midi), ces
villages sont sur le déclin dans les campagnes profondes, avec de moins en
moins de services locaux, parfois réanimés par des néoruraux, travaillant
dans les bourgades ou les villes proches, ou par des touristes, français et
étrangers, trouvant là leur résidence secondaire (Poitou-Charentes,
Ardèche). Dans les périphéries urbaines, ces villages accueillent une
population plus jeune - habitant souvent des lotissements -, et les activités
urbaines : zones commerciales et de services, échangeurs.
 |
 |
| Terrasses
abandonnées dans les Cévennes : un exemple de déprise
agricole... |
Usine
abandonnée dans le Nord : un exemple de friche industrielle... |
. bien distinguer paysages agricoles / paysages ruraux (extrêmement dynamiques dans la frange périurbaine, accueillant populations, activités, infrastructures de transport, zones industrielles, de services, notamment commerciales).
Aujourd'hui, les agriculteurs sont minoritaires dans les campagnes !
Ces paysages ruraux évoluent de façon très différente selon leur
localisation. Dans la proximité des grandes agglomérations, une forte
concurrence pour l’espace se traduit par le mitage des surfaces agricoles,
la rurbanisation – distinction de
plus en plus floue entre le rural et l’urbain). Dans les campagnes
enclavées, le vieillissement des agriculteurs posent la question de la survie
des exploitations, alors même que ces paysages de montagne, en particulier,
sont dotés d'une forte valeur patrimoniale (pour les Français et les touristes étrangers…)
D'une façon générale, la concentration des exploitations, leur insertion
dans une structure de marché subventionné posent la question de l'avenir de
la filière (crise du lait actuelle) et de la durabilité du modèle
productiviste dominant, catastrophique pour l'environnement (pesticides / qualité de l’eau / OGM).
La circulation des hommes et des biens + Se déplacer en France et
en Europe (CM1)
. la circulation des hommes et des biens manifeste la nécessité des
échanges dans une société marchande, ainsi que la disjonction (datant du
milieu du XIX° siècle) entre lieu de résidence et lieu de travail (de plus
en plus éloignés avec l'étalement urbain). Cette circulation s'observe à
deux échelles au moins, au niveau local (de l'agglomération et de la
région), ainsi qu'à l'échelle nationale, voire internationale, dans la
circulation entre villes.
. les grandes voies de communication unissent les principales métropoles
entre elles. Gares,
aéroports reliés au monde entier, autoroutes forment l'ossature du
réseau urbain. Le réseau des T.G.V. réunit les principales
métropoles, en France comme en Europe (les trains rapides d'Europe ont
d'abord desservi Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Francfort,
capitales économiques de l'U.E.) D'une façon générale, les
réseaux aérien, autoroutier et ferroviaire (traditionnel et TGV) sont
"en étoile", très centrés sur Paris, noeud ancien (XIX° siècle)
de ces réseaux.
. la condition de l’accessibilité et de la maîtrise du territoire :
les grands axes de communication assurent la rapidité et l'efficacité
des échanges et participent à la maîtrise du territoire, à son
maillage, à son accessibilité (le Massif central demeure encore un
espace difficilement maîtrisé). Ces axes, par leur diversité
multimodale (routes, autoroutes, trains - TGV qui participe au
"rétrécissement" de l'espace - voies maritimes et
fluviales...), déterminent aussi l'accessibilité des
métropoles, facteur au moins aussi important aujourd'hui que la
diversité des services offerte pour déterminer l'aire d'influence d'un
pôle urbain : pour jouer un rôle européen, voire mondial, les
métropoles françaises doivent être facilement accessibles du reste du
monde (d'où l'importance de disposer d'un aéroport international).
. l’axe majeur français, historique, Nord-Sud, européen [issu de la
liaison entre les deux anciennes capitales, Lugdunum (Lyon) et Paris, cet
axe unit France du Nord et France du Sud par la route, l'autoroute et le
T.G.V., héritier du P.L.M. (Paris-Lyon-Marseille) ferroviaire du XIX°
siècle, désormais prolongé vers la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord
par le carrefour européen de Lille].
|

|
| La France du TGV.
Une anamorphose, en cartographie, est une déformation de la réalité
géographique pour souligner la réalité d'un phénomène, ici
l'éloignement relatif des villes françaises en fonction de leur
situation par rapport au réseau TGV. Ici, on constate que certaines
villes se sont rapprochées de Paris, ou les unes des autres (à
remarquer le "rapprochement" de Marseille ou de Strasbourg,
à 3 heures de TGV). A l'inverse, la disparition de nombreuses gares
dans de petites villes, mal compensée par les efforts des
collectivités territoriales (autocars, TER), les gares TGV en dehors
des villes (Amiens / Valence / Avignon) ont "éloigné" ces
bourgades des métropoles, par rapport à leur situation de
1960. |
Pour l'instant, les Lignes à grande vitesse
(LGV) ne concernent que les passagers, et non le frêt. A l'échelle
nationale, le réseau renforce la centralisation parisienne : les projets en
cours visent à relier les dernières métropoles régionales (Toulouse,
Bordeaux) à la capitale. Le réseau TGV participe donc de la métropolisation
du territoire, et par conséquent, à l'échelle nationale, crée de nouvelles
inégalités spatiales (effet "banlieue" pour les villes bien
reliées, effet "tunnel" pour les autres). A l'échelle locale, le
TGV est un facteur de développement (pôles hôteliers, zones d'activités,
immobilier...)
. les efforts récents pour structurer davantage des liaisons vers l’est et le
sud : avec un centre de gravité européen qui s'éloigne vers l'est, en
raison des élargissements récents de l'Union européenne, la France doit
renforcer, comme l'Union européenne, ses axes Est-Ouest : le TGV
Paris-Strasbourg ainsi que le projet de grand tunnel
ferroviaire entre Lyon et Turin en sont des éléments (à noter
que la liaison Lyon Turin permettra en partie la circulation du frêt et donc
le ferroutage, le frêt ferroviaire étant un pilier du développement
durable). Pour l'heure, l'Europe des LGV est surtout celle de l'Europe du
Nord-Ouest, les périphéries du Sud et de l'Est restant à relier. Cette
perspective demeure lointaine vu l'absence d'une ferme volonté commune au
niveau européen, les priorités nationales primant sur la logique
européenne, les lobbies routiers, la rentabilité à long terme de ces
réseaux ferrés très coûteux.
. l'aéroport du programme peut s'étudier à l'échelle locale (emprise de
l'aéroport sur la commune, situation et site de cet aéroport, importance des
zones d'activités proches, impact sur l'économie locale) et à l'échelle
nationale et européenne (importance d'Orly ou de Nice pour les populations
d'origine maghrébine ou antillaise résidant en métropole). Les plate-formes
logistiques des aéroports, l'interconnexion entre différents modes de
transport (aérien et terrestre) mettent en relation ces deux échelles.
. ces grandes voies de communication, l'emprise au sol des installations
ferroviaires ou aériennes ont un impact considérable sur le paysage.
Les principales activités
économiques
Distinction traditionnelle entre secteur primaire (agriculture et
mines, cf ci-dessus), secteur secondaire (industrie) et secteur
tertiaire (services marchands et non-marchands).
Au cycle 3, une approche de ces activités par l'étude de paysages.
. la diversité des paysages industriels (5ème industrie mondiale), dynamiques
(sous la forme des technopoles, à proximité des agglomérations) et en
déprise (paysages fossiles des mines et industries du Nord-Pas-de-Calais).
|

|
| Le technopôle de
Metz (Metz 2000) : un exemple de zone où se côtoient industries
de haute technologie, université, grandes écoles... |
Ces paysages industriels sont marqués par les crises industrielles (sidérurgie / mines / textile du Nord, de la Lorraine, la région stéphanoise), la désindustrialisation sensible depuis 1975, les reconversions, la reconquête tertiaire des locaux (tennis dans d’anciens entrepôts, ateliers) et des espaces (bureaux, logements, hôtels…). Littoralisation de l’industrie, dissémination des implantations industrielles (discrètes, de taille plus modeste), notamment dans les espaces périurbains, ou en campagne, ou concentration d’activités de haute technologie dans les technopoles et autres parcs industriels, dans le périurbain, à proximité des voies de communication majeures…
Le tertiaire regroupe commerces, services, tourisme et loisirs, et marque l’évolution récente des paysages
:
. paysages immédiatement perceptibles par les élèves, multiples, liés au socle urbain (disparition tendancielle des services en zone rurale – postes, écoles, surtout dans le rural profond,
très à l'écart des agglomérations et des voies de communication, menacé de désertification…)
. des facteurs de localisation très liés à l’accessibilité et à la densité des zones de chalandise, dans une logique de déconcentration, de localisation périphérique (grandes surfaces, centre commercial, commerces d’entrées de
ville ou sur les rocades) : énorme impact sur le paysage… homogénéisé, enlaidi, défiguré…
|

|
| L'impact sur le paysage
de zones d'activité, industrielle et commerciale, en périphérie
nord de Reims : l'aménagement du boulevard des
Tondeurs... |
. des liens forts avec les réseaux et les moyens de transport , en particulier l’automobile…
. la France, pays le plus touristique du monde, la moitié des touristes
choisissant les régions méditérannéennes.
5 types de paysage
peuvent être proposés :
- espaces touristiques littoraux / montagne (stations d’hiver, tourisme vert) /
tourisme culturel des villes-patrimoine (les centres anciens) / tourisme
vert dans les zones rurales / les paysages articificiels des parcs de
loisirs.
Certains de ces paysages sont sursaturés, dégradés par le tourisme de masse.
D'où une série de mesures de protection de l'environnement paysager, les
plus anciennes remontant aux années 1920 : Parcs régionaux, nationaux, Loi
Littoral (1986), Loi Montagne (1985)
Le département et la région (cf ci-dessous)
Le territoire français dans l'Union européenne
(CM1)
Les grands types de paysages
. la notion de facteurs de diversité (relief, milieux bioclimatiques,
densités humaines, aménagements), France métropolitaine, France d’outre-mer…, débouchant sur une typologie des paysages, pris dans des dynamiques propres…
|
Critère naturel dominant |
Types de paysages |
|
Le climat et la végétation |
Paysage forestier, de garrigue, de
maquis, de landes |
|
Le relief |
Paysages de montagne, de plaine, de
littoral |
|
L’hydrographie |
Paysage lacustre, maritime (DOM-TOM), fluvial,
etc. |
|
Critère anthropique dominant |
|
|
Urbanité |
Paysages de banlieue, de
centre-ville, de zone commerciale, de ville nouvelle |
|
Ruralité |
Paysages de bocage, d’openfield,
paysages viticoles, etc. |
|
Activités industrielles |
Paysages de friches industrielles, de
technopôle, etc. |
|
Activités tertiaires |
Paysages touristique, commercial,
marqué par axes de transport |
D'après F.Simonis et O. Roux
. l’impact des climats sur la diversité des paysages français, en
milieu bioclimatique tempéré : climat océanique / climat continental / climat méditerranéen / climat montagnard / climat tropical des DOM, équatorial de la Guyane…)
 |
| Aux latitudes
moyennes, la France est soumise aux climats des régions
tempérées, la plus grande partie du pays étant sous l'influence
océanique... |
La diversité des régions françaises +
Le département et la région
dont l’outre-mer…
. communes (héritées de la Révolution en 1790)/ 101 départements (dont
5 d'outre-mer, avec la départementalisation de Mayotte, dans l'Océan
Indien)/ 22 régions métropolitaines (et 5 outre-mer, dont Mayotte, qui
ne dispose cependant pas de Conseil régional) : 3 échelles de maîtrise du territoire.
Les lois de décentralisation de 1982/1983 ont accordé de nouvelles
compétences à ces collectivités territoriales, autrefois sous la coupe
d'un préfet, et désormais dotées d'une assemblée
et d'un exécutif élus, avec des ressources financières propres. (A
suivre le projet d'une fusion des élus du département et de la région
sous la nouvelle appellation de "conseillers territoriaux").
Pour l'essentiel, les communes (souvent regroupées dans des structures
d'intercommunalité) gèrent l'urbanisme local et les écoles,
les départements l'aide sociale et les collèges, les régions les
transports (dont les TER) et les lycées, mais avec l'intervention de tous ces échelons
dans un certain nombre de domaines (aides économiques, soutien à la
culture, partenariats avec les régions européennes, etc.)
. certaines régions ont une véritable identité, héritée d'une
histoire, d'un sentiment d'appartenance, parfois d'une langue encore
vivace (Bretagne, Alsace, Corse, Nord-Pas-de-Calais). D'autres sont des
constructions plus artificielles, comme Rhône-Alpes ou
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Certaines sont très étendues
(Midi-Pyrénées), d'autres petites (Limousin, Franche-Comté). Les
contrastes de richesse et de densité sont également forts, par exemple
entre la région Ile-de-France ou la région Auvergne, au point de créer
de profondes disparités entre elles.
. à l'est d'une ligne Le Havre-Marseille, ou la Rochelle-Valence, on peut
distinguer une France plus industrielle, plus urbaine, plus densément
peuplée, par rapport à une France plus marquée par la ruralité dans la
France du sud-ouest.
Les frontières de la France et les pays de l'Union européenne
Au finistère de l'Europe, la France partage plusieurs frontières,
terrestres et maritimes, avec ses voisins européens, la frontière
historique avec
l'Espagne étant la plus ancienne. Trois types d'enjeu :
. le dynamisme de régions frontalières françaises, lié à
l'intégration européenne (cas de la région Rhône-Alpes, du Nord
Pas-de-Calais ou de l'Alsace, bien intégrées dans la dorsale
européenne).
. la libre-circulation des marchandises (suppression des postes
frontières) est effective dans l'Union européenne, depuis le traité de
Maastricht de 1993. La libre circulation des hommes est prévue dans l'espace Shengen,
qui réunit 22 Etats membres de l'U.E., plus la Suisse, la Norvège et
l'Islande. Ces Etats ont harmonisé leur politique de contrôle aux
frontières extérieures de l'U.E, leur politique de l'immigration et de
délivrance des visas. Le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie et la
Bulgarie n'adhèrent pas à l'espace Shengen. A signaler le statut de pays de transit de la France dans les flux migratoires
internationaux (le cas de Sangatte, puis de la "jungle" de
Calais).
. des régions françaises, autrefois périphériques, bénéficient de
l'intégration européenne, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine,
l'Alsace ou la Franche-Comté, notamment par les migrations quotidiennes
de travailleurs. Des coopérations transfrontalières, interrégionales,
sont encouragées par l'U.E dans son programme Interreg (Nord-Wallonie,
Manche-Angleterre, Arc atlantique...) pour donner forme à des
"eurorégions".
L’Union européenne
Voir cette carte
animée
L'U.E. ne constitue qu'une partie de l’Europe, avec des limites peu précises, politiques
avant tout ! (candidature du Maroc rejetée, de la Turquie acceptée… : les critères d’adhésion sont de nature politique et économique, pas religieuse ou culturelle).
Des élargissements successifs, depuis 1957 jusqu'aux 10 nouveaux entrants de 2004,
dont 8 situés dans l'ancien espace d'Europe de l'Est dominé par les
Soviétiques depuis 1945 (réunification de l’Europe divisée par la guerre froide).
|
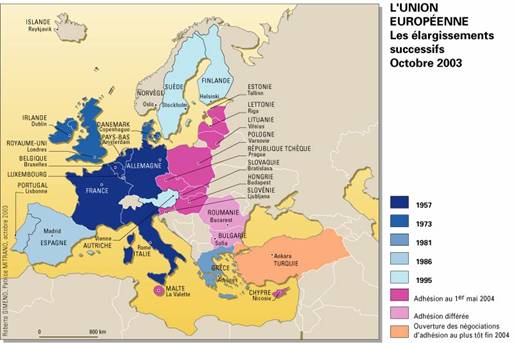
|
| L'élargissement
de 2004 manifeste le début d'une réunification politique d'une
Europe divisée, depuis 1945, par deux systèmes politiques
(démocratie libérale contre dictature du Parti-Etat) et économiques
(capitalisme contre planification autoritaire de la production)
opposés et hostiles l'un à l'autre. |
Désormais, l'U.E. compte 492 millions d’habitants et représente la
première puissance commerciale et économique du monde, l'un des 3 pôles de
la Triade qui organise les courants d'échanges de la mondialisation avec les États-Unis
et le Japon.
L'espace global de l'Union européenne réunit ainsi 27 territoires (espace
délimité par des frontières et soumis à une autorité politique) fort
divers par la superficie, la population, les résultats économiques, la
langue et la culture. Cet espace est un sous-ensemble dynamique, à l'ouest du
continent, de l'espace européen, qui s'étend jusqu'aux frontières
conventionnelles de l'Oural et du Caucase. Le territoire de l'Union
européenne est unifié par des règles économiques et commerciales uniques,
mais partagé en espaces dynamiques (autour de la mégalopole et de grands
agglomérations) et espaces plus ou moins intégrés à cette dorsale, plus ou
moins en retard, notamment à l'est (les nouveaux États-membres issus
de l'Europe communiste ne représentent que 5% du PIB des 15).
|
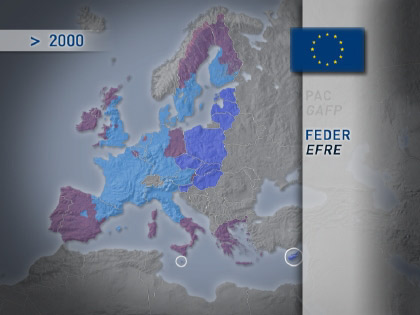
|
| En rose, les régions
considérées comme des périphéries nécessitant les aides du FEDER
(Fonds européen de développement régional). On y retrouve des
régions excentrées par rapport à la dorsale européenne (Portugal,
Irlande, nord de la Scandinavie), parfois en retard de développement
(Grèce, Corse, et ex-Allemagne de l'Est). |
L'U.E. est un espace d’échanges politiques pacifiques, de citoyenneté européenne, un
"modèle social européen" garantissant un niveau élevé de droits
et de protection sanitaire et sociale.
Un espace de libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, avec des frontières économiques communes, protégées, selon des inspirations libérales (libre concurrence, interdiction
des aides d’État) et d’orthodoxie budgétaire, avec un budget consacré avant tout à la
Politique Agricole Commune, puis à des politiques sectorielles, notamment de développement territorial des
régions ou des États les plus en retard...
Suite
|