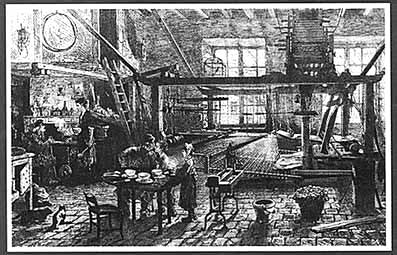|
Une
Europe en pleine expansion industrielle et urbaine à la recherche
de territoires et de débouchés : le temps de l'émigration et des
colonies
|
 |
La
Tour Eiffel,
le 26 décembre 1888 |
|
Organigramme
des relations entre les différents points du programme
( 80 ko) 80 ko) |

Méliès
fait du cinéma
|
B)
Révolutions industrielles : d'une France rurale
à
une France plus ouvrière et plus urbanisée
(à
partir de la 2ème moitié du XIX° siècle)
1)
De l'invention à la mécanisation : un mode de production
industriel
Tout comme l'Antiquité a inventé le verre, la
vis d'Archimède, la catapulte, le palan, les engrenages,
le moulin, la meule à grains, le Moyen Age la charrue,
le collier d'épaule, la herse, la faïence, l'horloge
et l'imprimerie, les inventions se sont poursuivies sous l'Ancien
Régime (première ascension en ballon par les frères
Montgolfier en 1783) et jusque dans les années révolutionnaires
(télégraphe aérien de Claude Chappe sur
les hauteurs de Belleville en 1793 et premières conserves
alimentaires par N. Appert en 1795, c'est le procédé
de l'appertisation). D'ailleurs, les écoles centrales
créées en 1795 privilégient l'enseignement
des sciences dans le secondaire.
La nouveauté du XIX° siècle, c'est que pour
la première fois dans l'histoire de l'humanité,
ces innovations techniques peuvent se diffuser de façon
massive, au point de transformer vie quotidienne et mode de production.
La clé de ce processus est la maîtrise de puissantes
et nouvelles sources d'énergie : ainsi, la première
révolution industrielle du début du XIX° associe
la machine à vapeur au charbon. La seconde, qui prend
le relais à la fin des années 1880, associe le
moteur à explosion (découvert en 1886) au pétrole
et à l'électricité.
Grâce à
d'énormes capitaux mobilisés par les premières
banques de dépôt et d'affaires ouvertes sous le
Second Empire (Crédit Lyonnais en 1863), aux prêts
à l'industrie, la production industrielle fait des progrès
considérables dans la métallurgie, la sidérurgie
(la tour d'Eiffel est un monument de fer) et la chimie, au travers
du chemin de fer, tandis que la mécanisation progresse
partout.
L'Exposition universelle de 1889, à Paris, est
une formidable vitrine de ces progrès techniques, des
premières automobiles à l'ascenseur électrique.
De nouveaux modes de distribution de produits plus abondants
et plus diversifiés (les premiers grands magasins ouvrent
sous le Second Empire), la constitution d'un véritable
marché national, grâce au réseau ferroviaire,
sont à la fois cause et conséquence de l'industrialisation,
qui transforme aussi profondément la vie ouvrière.
2) De l'atelier à l'usine
: un prolétariat dominé par la bourgeoisie
En effet, la révolution industrielle a pour cadre nouveau
l'usine, et non plus l'atelier artisanal ou la grande manufacture
dépourvue de machines.
Certes, en 1914, 28% des travailleurs
exercent encore leur activité chez eux, notamment les
ouvrières du textile, mais cela n'empêche pas le
développement des usines, même si la discipline
nouvelle qu'elles entraînent est longtemps contestée,
et les machines brisées.
|
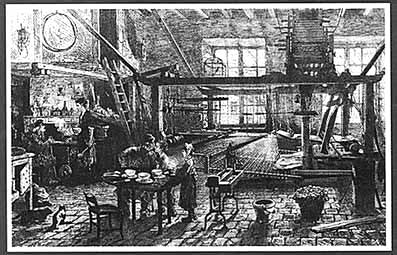
|
|
Atelier
domestique de canuts, à Lyon |
D'une façon générale,
et même si les différences sont profondes entre
le prolétariat d'usine et l'artisan qualifié, entre
l'ouvrier rural à domicile et le mineur, la condition
ouvrière a tendance à s'améliorer dans la
deuxième moitié du XIX° siècle et au
début du XX° : beaucoup de familles continuent de
vivre dans des logements insalubres, nombre d'ouvriers n'ont
que leur matelas pour seule richesse, mais ils mangent mieux,
davantage de laitages et de viande.
A partir de 1890, les gouvernements
réduisent la journée de travail (10 heures à
la veille de la guerre), suppriment le livret ouvrier, rétablissent
le repos hebdomadaire (supprimé en 1880). Mais les assurances-accident,
maladie, familiale et vieillesse sont inexistantes, sauf pour
certaines catégories sociales très particulières.
Les revenus patronaux ont eux beaucoup plus vite augmenté,
et une grande bourgeoisie d'affaires, capitaliste, apparue sous
le Second Empire, vient étoffer les rangs des hauts fonctionnaires
et des grands notables.
La bourgeoisie dans son ensemble diffuse
un mode de vie fait de goût pour le travail bien fait,
en prenant son temps, pour les loisirs tranquilles, sensible
pendant " la Belle Époque ".
|

|
| Le
Pont-Neuf et la Samaritaine (photographie de la série Rues et scènes
de rues, Paris, 1900-1929 des Frères Séeberger) |
Le " folklore
" de la civilisation rurale disparaît devant les progrès
d'une culture-marchandise, urbaine et industrielle, marquée
par le roman-feuilleton de la presse, le roman policier, le cinéma
et le sport-compétition.
3) De la campagne aux faubourgs
et aux banlieues :
une société de plus en plus homogène et
urbaine
Avant guerre, la société française reste
majoritairement peuplée de ruraux, mais l'urbanisation
progresse (31 % de citadins en 1870, 47% en 1911 ; la proportion
sera renversée seulement à partir de 1928).
Cette
urbanisation est directement liée à l'industrialisation
: elle est nourrie par l'exode rural qui se fixe dans les usines
des faubourgs et des banlieues des cités industrielles.
Usines, entrepôts, logements ouvriers s'installent à
la périphérie sur des espaces plats bien desservis
par les transports.
|

|
|
Les
usines Frey à Guebwiller : l'urbanisation se développe autour,
avec les maisons ouvrières dominées sur leur arrière par les
fameuses maisons de maître... |
La naissance de la banlieue crée les
premières agglomérations : la ville absorbe les
communes périphériques (Paris annexe ainsi les
communes de Montmartre, Belleville, Grenelle... en 1860) gagnant
encore en espace.
Des régions rurales entières se vident (les Alpes,
le Massif Central) alors que de véritables régions
industrielles se forment ou se développent autour des
gisements de houille (dans le Nord, autour du Creusot ou de Saint
Etienne), de l'hydroélectricité (Grenoble) ou de
savoir-faire industriels anciens (Paris, Lyon, Lille, Rouen ...
)
Alors que la France est entrée dans une période
de stagnation démographique, les migrations d'Italiens,
de Polonais (comme Marie Curie, née Sklodowska), de Belges
viennent alimenter les recrutements d'ouvriers.
|