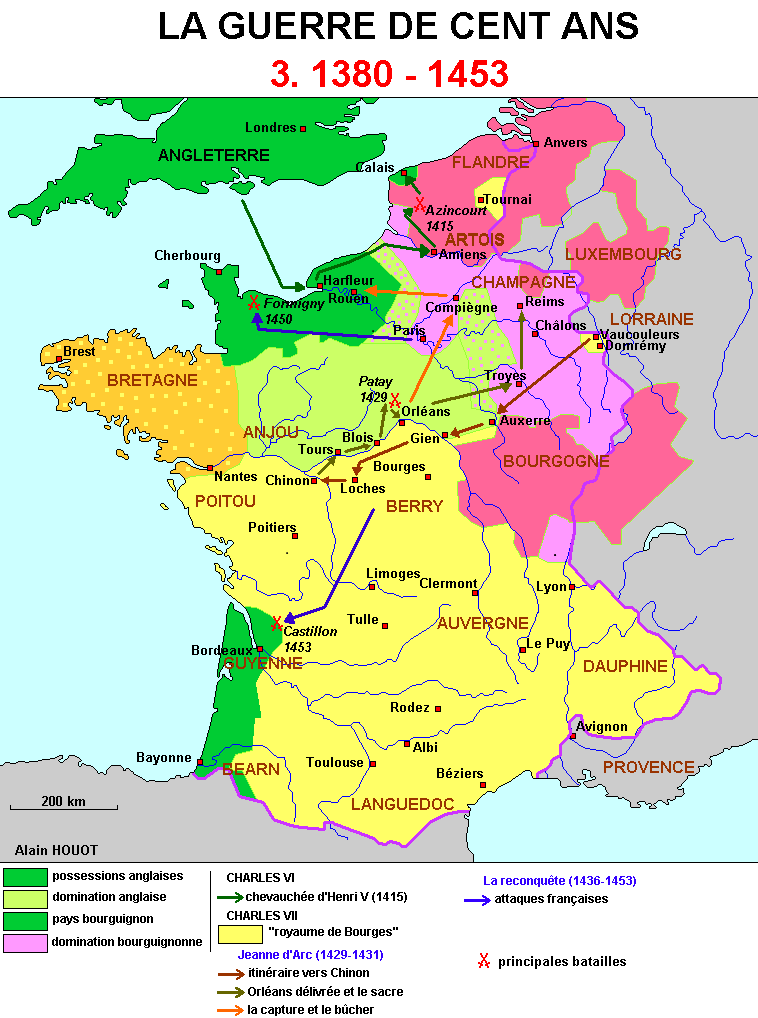|
|
II) ... malgré les temps difficiles Il faut conserver en mémoire cette victoire de l'autorité
royale, dans un État renforcé (création de la poste,
qui accélère la transmission des ordres royaux,
par Louis XI) en abordant la fin du Moyen Age, marquée
par les trois cavaliers de l'Apocalypse (la guerre, les épidémies,
la famine). De ces deux siècles d'épreuves, le
royaume sort transformé, avec un affaiblissement de la
noblesse, l'essor politique et social de la bourgeoisie commerçante
des villes, sous l'autorité du roi. A) La guerre de Cent Ans (1338-1453) Cette guerre, qui n'a pas duré cent ans parce qu'entrecoupée
de longues périodes de trêve, est le dernier exemple
de conflit féodal entre deux États en construction et
rivaux pour imposer leur suprématie à toute la
chrétienté (Philippe Auguste et Richard Cœur
de Lion ont conduit ensemble la troisième croisade).
Les débuts de la guerre qui s'ensuit sont très favorables aux Anglais. 1346 : victoire de Crécy. 1356 : victoire de Poitiers (le roi Jean le Bon est capturé et emprisonné à Londres) qui impose la cession en 1360 de parties considérables du royaume, du Poitou à l'Aquitaine. Il faut toute l'énergie de Charles V et la guérilla de Du Guesclin pour reconquérir l'essentiel du pays, vers 1375, quand s'achève la première phase de la guerre. Au milieu du désastre, une paysanne de 16 ans Elle rebondit en 1415 avec la victoire anglaise d'Azincourt qui décime la chevalerie française. Alliés aux Anglais, les ducs de Bourgogne combattent l'autorité royale. En 1420, avec l'aide bourguignonne, le roi anglais impose le Traité de Troyes par lequel Charles VI, le roi fou, déshérite son fils au profit d'Henri V de Lancastre, qui devient son gendre. Le dauphin français ne règne plus que dans son "royaume de Bourges", où il s'est réfugié, tout le nord et l'est de la Loire étant occupés par ses ennemis. Survient Jeanne d'Arc, en 1429, qui permet le sacre, accompli à Reims, en pleines terres bourguignonnes : Charles VII peut désormais compter sur la légitimité divine.
Patiemment, abandonnant Jeanne à
son sort, - elle est brûlée vive à Rouen en 1431, à 19 ans - Charles VII reconquiert son royaume, ne laissant aux
Anglais que Calais, après la victoire de Castillon en
1453, la dernière bataille de la guerre de Cent Ans. 1453 : une date charnière En même temps que la fin de la guerre de Cent Ans, 1453 marque une autre date essentielle dans l'histoire des hommes. En effet, c'est le 29 mai 1453 que Constantinople, la capitale de l'empire byzantin, chrétien, cède aux assauts du Turc musulman Mehmed II le Conquérant. Le sultan rebaptise la ville Istanbul et en fait la capitale de l'Empire Ottoman. Cette avancée de l'Islam provoque le reflux vers Rome et l'Occident des penseurs, des scientifiques et des archives byzantines, héritage des oeuvres et de la culture de l'Antiquité. Cet afflux de la culture et de la science byzantines sera en partie à l'origine de la Renaissance européenne. Pour certains historiens, 1453 marque ainsi la fin du Moyen Age et le début de l'époque moderne. |
|
|