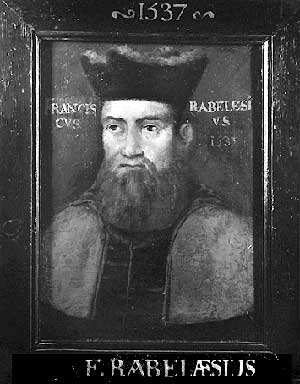|
|
II) L'invention de valeurs universelles
: A) Au XVI° siècle, l'humanisme de la Renaissance... Tout au long du XV° siècle, la vitalité
des cités marchandes italiennes permet aux grands négociants
et banquiers de concurrencer politiquement et socialement le
pouvoir de la noblesse. C'est ainsi que la famille bourgeoise
des Médicis parvient à dominer Florence.
Autodidactes ou formés dans des ateliers qui pour la première
fois échappent à l'emprise de l'Église, des peintres
comme Boticelli ou Léonard de Vinci,
des sculpteurs comme Donatello (qui réintroduit le nu
dans l'art occidental), des architectes comme Alberti ou Bramante
inventent un Beau idéal, auquel prennent part Dieu, l'esthétique,
avec le modèle de l'Antiquité, et les mathématiques,
avec le respect de la perspective et des proportions.
Dans le même temps où les artistes signent leurs
œuvres et sortent de l'anonymat de l'atelier, des écrivains
humanistes comme Érasme, puis Rabelais célèbrent
la dignité de l'homme, placé au centre de l'univers
: par la connaissance, l'étude des textes antiques (l'Occident
redécouvre alors le grec) que l'imprimerie permet de multiplier,
le recours à la raison, l'homme peut échapper aux
superstitions et à l'obscurantisme, surmonter intolérance
et conflits guerriers.
François Ier, un mécène de la Renaissance Dans le royaume de France, François
ler (1515-1547) encourage la Renaissance, avec sa sœur
Marguerite de Navarre : il s'entoure d'artistes italiens comme
Léonard de Vinci, confie au Rosso la décoration
du château de Fontainebleau, favorise l'éclosion
d'un art renaissant français dans l'édification
des châteaux de la Loire (Chenonceaux, Chambord), des Tuileries à Paris (Philibert Delorme, Jean
Bullant) ou la reconstruction du palais royal du Louvre (Pierre
Lescot).
En outre, François ler fonde le
Collège des lecteurs royaux, ancêtre du Collège
de France, où de grands savants humanistes enseignent
la philologie, le grec, l'hébreu, les sciences. |
|
|