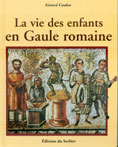|
La Gaule et la romanisation
|
|
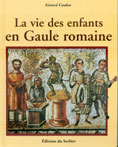 |
|
La vie des enfants
en Gaule romaine
|
 |
|
Vivre comme les
Romains,
De la Martinière |
|
B)
Les Gallo-Romains : une symbiose ethnique et culturelle
La conquête romaine a entraîné (outre morts
et dévastations) des bouleversements considérables
: une romanisation des pays celtes, partie intégrante
de l'empire romain.
l'armée construit un dense réseau routier qui
unifie le territoire des Gaules. Les camps permanents des soldats
sont parfois à l'origine de villes (Strasbourg, en arrière
du limes sur le Rhin). Des vétérans sont
installés sur des terres confisquées ou dans de
nouvelles colonies romaines ;
de nombreuses villes sont créées (Autun à
la place de Bibracte), d'autres agrandies, surtout dans le sud.
Elles sont toutes unifiées autour d'un urbanisme typiquement
romain : un centre, le forum, où se croisent cardo
et decumanus (les 2 axes principaux de circulation Nord-Sud
et Est-Ouest), centre politique (curie, basilique) et
religieux
(capitole) de la ville ; des monuments urbains de pierre (amphithéâtre
- à Lyon en 177 -, cirques, thermes, odéons, temples...),
y compris dans des bourgs (vicus), y compris près de lieux
de pèlerinage et de cultes celtes (sources). C'est une
civilisation urbaine de l'ostentation (évergétisme),
de la rhétorique (écoles municipales), du loisir (thermes, théâtres) à partir des surplus du commerce et de l'exploitation de la terre ;
|

|
Vestiges de la maison
dite " du buste en argent ", dans le quartier de la Villasse, sur le site de fouilles, à Vaison-la-Romaine
(Vaucluse)
|
le culte impérial se diffuse, au niveau municipal
(temple de la Maison carrée à Nîmes) et provincial
(autel de Rome et d'Auguste à Lyon, avec les délégués
des cités des Trois Gaules). Mais la conquête romaine
a su s'appuyer sur les anciennes aristocraties gauloises pour
durer et assimiler progressivement les différentes ethnies
présentes en Gaule ;

|
|
La Maison carrée,
les arènes et la tour Magne, à Nîmes (peinture
d'Hubert Robert 1733-1808)
|
les élites gauloises font tout pour s'intégrer
dans les couches dirigeantes de l'empire. Elles prennent des
noms romains : intégrées à l'administration
des Gaules, elles recherchent une promotion sociale et politique,
et d'abord la citoyenneté romaine (accordée à
tous les hommes libres de l'empire en 212, par l'empereur Caracalla).
Pour la première fois en Gaule, une classe de riches industriels
et commerçants prospère (les thermes de Paris financés
par la corporation des armateurs de la Seine, les nautes) ;
une symbiose religieuse se manifeste : Sucellus, dieu au
maillet typiquement gaulois, prend l'aspect du Jupiter romain.
Le druidisme disparaît au profit des religions orientales,
dont le christianisme. Implanté dans la vallée
du Rhône au IIème siècle, il pénètre
d'abord les villes (Lyon) puis les campagnes grâce au zèle
d'évêques (dont le rôle est de plus en plus
éminent dans la ville) comme St Martin (lire un épisode
célèbre de sa vie), fondateur du monachisme
en Occident. Jusqu'au III° siècle, le christianisme
est persécuté, les fidèles refusant notamment le culte dû à
l'empereur. En 313, l'édit de Milan de l'empereur Constantin tolère
la nouvelle religion. A la fin du IV° siècle, l'empereur Théodose
interdit les sacrifices aux dieux païens et les Jeux Olympiques et
proclame le christianisme seule religion de l'empire ;
- le latin se diffuse et supplante les dialectes celtes.
"Le latin était probablement assez largement compris d'une
bonne partie de la population dès le Ier siècle av. J.C. : les
nombreuses inscriptions funéraires gravées à cette époque
pouvaient être lues, sinon elles n'auraient pas eu de raison d'être.
Cela prouverait qu'un enseignement primaire, destiné à
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, dispensé par un
maître d'école aux enfants de sept à onze ans, était
généralement suivi. Ce n'était, en revanche, que les
enfants de milieux plus favorisés qui suivaient, pendant quatre ou
cinq ans, les cours plus approfondis des grammairiens. Ils pouvaient
par la suite acquérir à l'université la culture indispensable à
qui voulait faire une carrière publique en étudiant l'art oratoire
et la rhétorique" (F. Beck et H. Chew, Quand les Gaulois
étaient romains, Découvertes Gallimard, 1989).
Cette romanisation marque profondément
le paysage par les villes, les ouvrages d'art (aqueducs), les
villas (d'immenses exploitations agricoles et artisanales, qui
placent dans la dépendance et la justice du maître
des centaines de paysans libres ou esclaves), la cadastration
du territoire.
Elle marque aussi durablement la civilisation : à partir
du début du IV° siècle, colons et esclaves
chasés entrent dans la dépendance du maître
: les plus pauvres entrent dans le patronage des plus puissants,
l'aristocratie gallo-romaine. Être paysan devient une condition
héréditaire. En ville, l'obligation s'impose de
reprendre le métier de son père. Il s'agit de fixer
les individus sur le sol et dans leur condition pour faire face
aux invasions et aux troubles sociaux (crise démographique
et bagaudes - révoltes populaires - du III° siècle,
fin IV° et début V°). Ces hommes libres qui recherchent
la protection d'un "patron" et se mettent à
son service, c'est la préfiguration du monde médiéval.
|