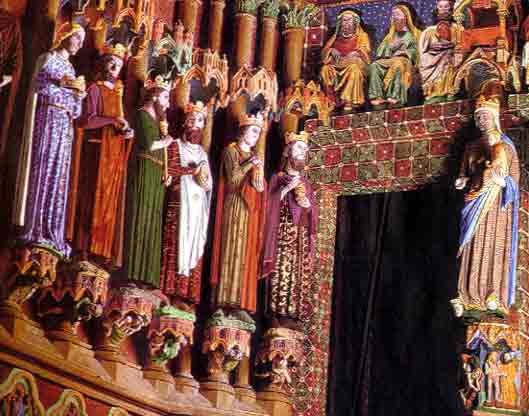|
|
C)
La christianisation d'une société soumise à l'Église
Soutien essentiel de la monarchie (depuis Clovis), l'Église
catholique essaie d'imposer ses propres normes et ses propres
hiérarchies à une société féodale
violente et guerrière. D'abord en se rendant indépendante
des rois, des princes et des seigneurs. C'est l'objectif de la
Réforme Grégorienne (du nom du pape Grégoire
VII, XI° s.) qui arrache aux grands laïques les nominations
ecclésiastiques. Ainsi, l'évêque est-il élu
par les chanoines du chapitre cathédral.
Peu
à peu, l'Église parvient à "moraliser"
les comportements sociaux des grands, notamment en imposant la
monogamie et le mariage non consanguin, avec le consentement
des deux époux, en disposant de l'arme de l'excommunication
(le Capétien Philippe ler, à la fin du XI°,
est excommunié trois fois pour avoir voulu épouser
sa maîtresse et légitimer ses enfants bâtards).
L'Église tente aussi de discipliner la violence des puissants,
en décidant, aux alentours de l'an mil, "la paix
de Dieu" (qui protège certains lieux d'asile comme
les églises et certaines catégories sociales comme
les paysans, les clercs, les marchands, les pèlerins,
les veuves - Serment de paix à Beauvais - 1023) et "la
trêve de Dieu" (qui interdit la guerre pendant des
temps religieux forts comme Pâques, et du vendredi au dimanche).
 |
| Bénédiction des
armes par l'évêque avant la bataille |
Les croisades sont enfin le moyen de détourner la violence
des guerriers contre l'infidèle, contre le "Mahométan" (loin en
Palestine), en échange d'une promesse papale d'indulgence (la mort en Terre Sainte vaut
absolution des péchés). Mais ces croisades peuvent également
susciter l'enthousiasme des foules. Ainsi, même des enfants se jettent sur
les routes dans l'espoir de libérer Jérusalem, aux mains des Musulmans
depuis 638. En 1212, des troupes d'enfants et d'adolescents, venus surtout
du nord-est de la France, des Flandres et de la vallée du Rhin se dirigent
vers les ports méditerranéens. Beaucoup meurent en chemin, les autres
seront vendus comme esclaves ou périront noyés.
Malgré les menaces d'excommunication, l'Église a fort à faire pour faire respecter ses propres
valeurs, qui se diffusent néanmoins par le biais de ses
institutions : exemples du monachisme, des monastères ruraux (avec la
remise à l'honneur de la prière, comme à
Cluny, de la pauvreté et du travail, comme chez les Chartreux,
près de Grenoble), pèlerinages auprès des
reliquaires, hôpitaux (hôtels-Dieu), écoles...
|
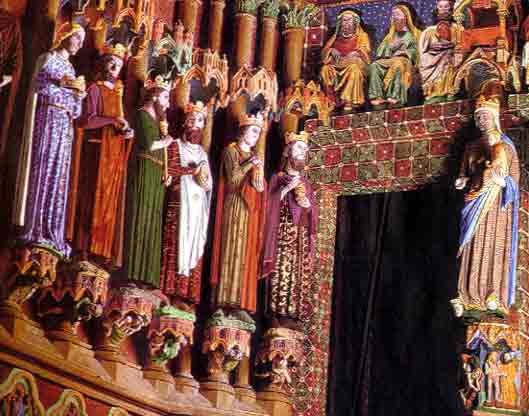
|
| La
cathédrale d'Amiens "mise en lumière" pour retrouver la polychromie
d'origine. L'intérieur et l'extérieur des cathédrales gothiques
étaient peints, en particulier les piliers et les statues. Les
vives couleurs avaient un impact certain sur le petit peuple qui
vivait dans des vêtements gris. |
Cette christianisation en profondeur de toute une société
s'opère enfin dans l'existence quotidienne : calendrier
chrétien dont les fêtes (Pâques, Noël
... ) et les saints rythment la vie de la paroisse, dont le curé
enregistre l'état civil et assure soin des âmes
et éducation de tous, où même les analphabètes
lisent sur le tympan, les sculptures, les fresques et les vitraux
des églises romanes et gothiques scènes des Évangiles et Jugement Dernier.
Des distributions collectives d'aumônes, par des monastères, des
maisons-Dieu (pour les malades et les pèlerins) peuvent concerner plusieurs
milliers de pauvres - cette tradition traversant tout l'époque
moderne.
| Dates |
Fêtes religieuses |
Nature de l'aumône |
| 1er
novembre |
Toussaint |
Pain |
| 25
décembre |
Noël |
Pain |
| 6
janvier |
Épiphanie |
Pain |
| 22
janvier |
St
Vincent |
Pain |
| Février |
Lundi
gras |
Lard
(cochon) |
| Mars
ou avril |
Pâques |
Pain |
| Mai
ou juin |
Pentecôte |
Pain |
|
Tableau
tiré de la thèse de Pascal Hérault, Assister et soigner en
Haut-Poitou sous l'Ancien Régime : la maison-Dieu de Montmorillon du
début des guerres de religion à la Révolution, 1996. L'auteur
précise que ces aumônes générales commencent dès le XIV°
siècle. |
|
A Montmorillon, les aumônes
sont distribuées dans le cimetière. A l'abri de l'église
paroissiale, le cimetière est un très important lieu de
sociabilité. Souvent bien communautaire, c'est un lieu de passage -
jusqu'à leur clôture en 1695 -, et de réunion. On y joue, parfois
au jeu de paume, on y danse, on y tient le marché... Verdoyant,
l'herbe y pousse, affermée aux paysans, mais aussi les arbres, les
fruitiers... Traditions qui là aussi dureront jusqu'au début du
XVIII° siècle, malgré l'édit de Louis XIV...
|
|